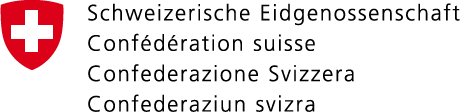COVID-19: et après?
La pression d’un rythme effréné, des paramètres à gérer en constante mutation et le besoin de prendre le temps de la réflexion personnelle: dans une tribune à la NZZ, le conseiller fédéral Ignazio Cassis revient sur une année hors du commun. Qui décide de la valeur d’une vie humaine? Quelle est l’importance des frontières ouvertes? Et que restera-t-il de cette période lorsque nous reviendrons à la normalité? Une rétrospective personnelle.

Que reste-t-il après une année de COVID-19? Quelles sont les conséquences de la pandémie sur la santé, mais aussi sur l’économie et la société? Dans une rétrospective toute personnelle, le conseiller fédéral Ignazio Cassis revient sur une période intense et mouvementée. © Keystone
L’image qui me revient est une vue aérienne d’un chantier de construction, avec des milliers de personnes, des grues, des excavatrices – véritable fourmilière humaine. Une vue en accéléré, et simultanément, l’instantané emblématique de toute une génération. De ce point de vue, vouloir résumer la pandémie de COVID-19 en une seule image relève quasiment de l’impossible. Et pourtant, cette photographie reste gravée dans mon esprit et illustre le début de cette crise comme nulle autre représentation: la construction de l’hôpital de Wuhan.
À un moment où le nouveau virus était encore perçu comme une vague atteinte respiratoire et représentait surtout un problème pour les autres, les autorités chinoises se lançaient dans la construction d’un ensemble hospitalier d’une ampleur quasi impossible à saisir pour nos esprits européens. En Suisse, un projet de construction dans le domaine de la santé publique peut durer jusqu’à trente ans, même s’il ne suscite aucune opposition. En Asie, il est possible de confiner des métropoles économiques et de mettre en quarantaine trente millions de personnes en quelques heures, et de faire surgir de terre de nouveaux bâtiments en un temps record. Je me souviens avoir été fasciné par ces photographies – fascination purement technique, certes.

L’art de crier au loup à bon escient!
Il ne s’écoulera toutefois guère de temps avant que l’intérêt scientifique prenne un tour très émotionnel. Le 25 février, le Dr Pietro Antonini, de la clinique Moncucco à Lugano, signale le premier cas de COVID en Suisse. Au Tessin. Dans ma ville. Des années auparavant, j’avais participé, en tant que médecin cantonal, aux préparatifs de lutte contre une épidémie à l’occasion du SRAS et de la grippe aviaire. La Suisse s’y était préparée. Cependant, l’être humain a deux facultés: il oublie rapidement et a du mal à prendre ses responsabilités. Le risque de tirer la sonnette d’alarme trop tôt est toujours présent.
Si vous prenez des mesures prématurées et que l’épidémie se révèle sans conséquence, vous serez accusé de surréagir. Et si vous en faites trop peu, des voix critiques ne tarderont pas à s’élever pour vous reprocher votre imprévoyance. Ceux qui doivent prendre des décisions dans l’incertitude générale ont peu à gagner et beaucoup à perdre. Passer de la simple réflexion à l’action concrète exige du temps – luxe qu’une crise, par définition, offre rarement! Cela nécessite aussi du courage, celui de déclencher l’alarme sans connaître l’ensemble des faits.
Avons-nous pris les bonnes décisions?
Face aux incertitudes suscitées par l’absence de données factuelles probantes, les processus préétablis peuvent se révéler utiles. Pour le Conseil fédéral, cela consistait à garder son calme et à appliquer rigoureusement les mesures décrites dans les plans de pandémie. Et comme les plans le prévoyaient, les premiers soubresauts ont agité la société. Nos concitoyens ont commencé à se soucier de quelque chose que nous considérons habituellement comme acquis: la santé. Je me souviens précisément de ces premiers jours, lors desquels les événements et le ressenti de la situation évoluaient pratiquement d’heure en heure, même au sein du Conseil fédéral. Avec un altimètre oscillant constamment entre des hauteurs stratosphériques et la basse atmosphère, entre la sécurité sanitaire nationale et l’assortiment des commerces locaux.
La situation avait quelque chose d’insensé, avec l’impression de débuter une compétition sans aucun échauffement. Et surtout de prendre le départ d’une course sans savoir s’il s’agissait d’un sprint ou d’un marathon. Diriger soudainement la Suisse en vertu du droit d’urgence et exercer les pleins pouvoirs étaient une expérience nouvelle et quasi inconcevable. Jamais, depuis la Seconde Guerre mondiale, la Suisse n’avait eu à gérer une crise par le biais du droit d’urgence. Et jamais, auparavant, il n’avait été question de mobiliser des moyens financiers aussi colossaux pour faire face à une crise. Il s’en est suivi de nombreuses nuits blanches et une question angoissante: avons-nous pris les bonnes décisions?

Le temps et le recul apporteront les clarifications nécessaires
Si les livres d’histoire nous rappellent qu’il faut d’abord sauver les femmes et les enfants lors d’un naufrage, nous mettons par analogie l’accent sur les personnes âgées et les malades chroniques. Est-ce juste? Est-ce faux? Qui détermine la valeur financière d’une vie humaine? Dans le cadre du régime de droit d’urgence, le Conseil fédéral bénéficie de pouvoirs décisionnels étendus. Une responsabilité difficilement quantifiable qui, pour être assumée, exige une réflexion approfondie et donc du temps, même en situation de crise. Le rythme est toutefois trop rapide pour permettre d’aborder les enjeux éthiques et socio-philosophiques fondamentaux. L’absence de débat sur ce sujet est source de conflits.
Le Conseil fédéral est prêt à débloquer 40 milliards de francs, ce qui correspond à 40% de la dette brute de la Suisse. Dépenser une telle somme qui ne vous appartient pas et créer ainsi une dette pour les générations futures fait apparaître un conflit intergénérationnel si embarrassant que personne ou presque ne veut s’exprimer sur la question. Seule une analyse rétrospective de la situation permettra de savoir si nous avons fait le bon choix.
L’économie perçue comme l’ennemie de la santé
Dans le contexte actuel, nous n’avons, en tant que société, pas le temps de mener une réflexion philosophique sur ce thème et manquons cruellement de recul. Par peur de nous faire des ennemis, nous préférons garder le silence. Les partisans de la santé sont hostiles à l’économie, et ceux qui veulent sauver l’économie sacrifient des vies humaines: cette vision manichéenne superficielle est une conséquence de notre prospérité. Les pays pauvres n’ont pas été confrontés à ce débat, car ils ne pouvaient pas se le permettre financièrement. Dans bien des pays, l’accès à la santé et à la prospérité ne va pas de soi; par ailleurs, de nombreuses cultures considèrent que la mort fait partie de la vie – le caractère éphémère de l’existence constituant dans ce cas un élément du débat de société.
La Suisse a pu, pendant longtemps, faire l’économie de ce débat. Reste que sa prospérité repose sur sa force économique. Ceux qui opposent la santé et l’économie ignorent le fait que le revenu est un facteur déterminant de la santé d’une nation. L’économie et la santé sont les deux faces d’une même pièce. Une telle opposition est artificielle. Le conflit est inutile et nuisible. Pour qu’une société soit en mesure de se développer, elle doit pouvoir compter sur des individus en bonne santé, des emplois et des ressources financières. La prospérité n’est pas l’ennemie de la santé, mais son fondement.

Fermer les frontières et sauver des vies!
La frustration face à nos pensées et à nos actions moralisatrices me poursuit depuis l’année dernière. Cette approche est éprouvante et dénuée de toute réalité. Comme si une crise pouvait être maîtrisée à coup de slogans manichéens! Si la pandémie nous a montré une chose, c’est bien celle-ci: une approche agile fondée sur le principe d’essai et d’erreur n’aboutit peut-être pas à une solution parfaite, mais elle sera toujours préférable à une doctrine centralisatrice prompte à opposer les deux piliers de notre prospérité. Car la Suisse n’est pas un îlot de prospérité béni des dieux et à jamais protégé.
Notre prospérité et notre système de soins de santé moderne reposent avant tout sur une économie efficace, soutenue en particulier par la vigueur de nos exportations. C’est notamment en période de crise de la mondialisation, lorsque les frontières nationales regagnent en importance, que des appels à leur fermeture se multiplient: on passe de la démarcation à l’isolement. La crise sanitaire a mis en évidence notre relation ambivalente à l’identité nationale et a placé les questions de développement social évoquées ces dernières années au centre de l’agenda politique et médiatique.
Les régions frontalières, espaces de vie et d’activité économique
Les discussions sur la fermeture des frontières étaient caduques dès le départ. La pandémie progressait rapidement et imaginer qu’elle puisse s’arrêter aux frontières relevait davantage d’un vœu pieux nourri par la peur que d’une gestion réaliste de la crise. Mais le débat a révélé à quel point nous sous-estimons les régions frontalières en tant qu’espaces de vie. Les frontières ne sont pas seulement des délimitations créatrices d’identité, elles sont aussi des lignes de rencontre entre les pays et les cultures, des espaces de vie et d’activité économique pour des milliers de personnes. C’est ainsi que les systèmes de santé du Tessin et de Genève sont restés opérationnels grâce aux travailleurs frontaliers italiens et français.
À Constance et à Kreuzlingen également, la puissance symbolique de cette ligne de rencontre était frappante: la consternation et la protestation collective déclenchées par les grillages brièvement érigés sur la frontière commune soulignent à quel point les images de l’histoire sociale de l’Europe sont ancrées dans notre mémoire collective. Nous vivons, aimons et travaillons dans ces régions, non pas en dépit des frontières, mais grâce à elles et avec elles. Une fermeture complète de la Suisse n’a donc jamais été envisagée. Nous avons peut-être parlé techniquement d’une fermeture des frontières, mais en réalité, les frontières ont toujours été ouvertes pour les marchandises et partiellement ouvertes pour les personnes.

La souveraineté cantonale dans la conscience collective
En tant que citoyen d’un canton frontalier, je ressens profondément l’importance de cette ligne de rencontre. L’unicité de ce bien culturel m’a été constamment rappelée durant la pandémie, à l’occasion de mes déplacements hebdomadaires à Berne. Nous avons vécu au Tessin une expérience dramatique qui s’évanouissait à l’entrée sud du tunnel du Gothard. Je pénétrais dans le tunnel et la pandémie semblait disparaître dans ses confins obscurs. J’ai réalisé que la pandémie soulignait les composantes géographiques et culturelles de la Suisse – pour le meilleur et pour le pire. Le fait que l’épicentre européen de la pandémie se situait à Milan et que le Tessin a été touché beaucoup plus tôt et beaucoup plus sévèrement que le reste du pays a induit chez moi une perception complètement différente de la situation.
La pandémie a révélé de manière impressionnante les décalages de perception qui existent en Suisse. Elle a rendu visibles nos différences, mais aussi notre attachement collectif à la souveraineté cantonale. Le fédéralisme n’est pas une formule historique à la mode, mais le reflet d’une réalité culturelle et géographique. Le développement du fédéralisme s’apparente depuis toujours à un savant exercice d’équilibriste entre les échelons institutionnels – fédéral et cantonal.
Il y a encore loin de la coupe aux lèvres
Le pouvoir crée une dépendance, et cela à tous les niveaux. Le fédéralisme en est l’antidote. Il oblige à faire preuve d’humilité, de tolérance et à supporter ceux qui pensent différemment. Ce sont précisément les négociations difficiles, les discussions sans fin et la délimitation claire des responsabilités qui constituent le fondement de notre cohésion nationale. Le fédéralisme doit néanmoins pouvoir s’appuyer sur le sens civique de la population, surtout en temps de crise. Une vertu qui a perdu de sa substance ces derniers temps dans la cacophonie entourant les mesures à prendre. Alors qu’au printemps dernier, nous luttions encore contre ce virus d’un genre nouveau dans une logique d’appartenance collective, il faut désormais admettre que plus le temps passe, plus le ton se durcit. D’aucuns exigent des mesures plus strictes, alors que d’autres souhaitent un assouplissement tant attendu. On ne s’écoute plus, on s’invective. La recherche du dialogue fait place à la confrontation.
Il serait temps de nous souvenir ensemble de nos valeurs fédéralistes. Parce que la persévérance porte ses fruits. L’augmentation des capacités de dépistage, le traçage des contacts et les vaccins font briller une lueur d’espoir à l’horizon. Nous devons toutefois accepter de poursuivre ensemble et avec cohérence la voie que nous nous sommes tracée. À l’heure où l’optimisme commence à poindre comme les premières fleurs du printemps, nous sommes menacés par un nouvel hiver, celui de la troisième vague. Il ne tient qu’à nous de ne pas nous laisser surprendre par les rigueurs de ses frimas glaçants. Et de lutter ensemble pour la liberté à laquelle nous aspirons.
Cet article est paru dans la NZZ du 6 avril 2021.